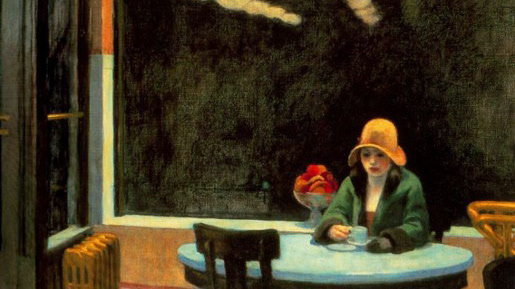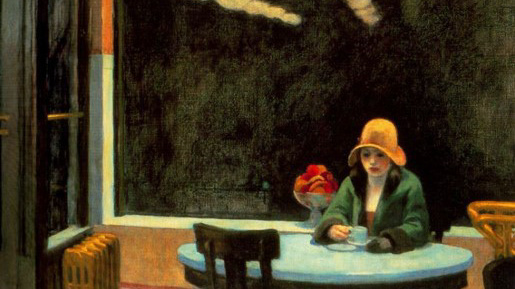William Henry Clapp est né en 1879 à Montréal de parents américains. C’est à l’école de l’Art Association of Montreal qu’il débute sa formation sous la direction de William Brymner. De 1904 à 1907, Clapp fréquente quelques académies à Paris et, par la suite, il voyage en Europe. Découvrant l’impressionnisme lors de ce séjour, il se passionne pour l’éphémérité de la lumière principalement lorsqu’elle dissout la forme et que le peintre doit la recomposer à partir de ses sensations visuelles qui sont le fondement de son expérience. Clapp est de retour à Montréal en 1910, il sera élu l’année suivante membre associé de l’Académie royale des arts du Canada. En 1915, Clapp quitte définitivement le Canada pour s’installer d’abord à Cuba, puis à Oakland, en Californie, où il fonde sa propre école. D’ailleurs, il sera conservateur de l’Oakland Art Gallery de 1920 à 1949. Il s’est éteint en 1954 à l’âge de 75 ans.
Ce paysage rural, peint entre 1908 et 1915, mesure 94 cm de largeur et 74 cm de hauteur, soit à peu près la moitié d’une porte mise à l’horizontale. La Moisson est une huile sur toile qui révèle toute la splendeur du pointillisme. Georges Seurat est le précurseur de cette technique du mouvement néo-impressionniste qui consiste à juxtaposer deux points de couleur différente au sein desquels survient une division systématique du ton. C’est-à-dire que deux points voisins de couleur différente se mélangent au niveau de la perception rétinienne. Ce phénomène est aussi connu comme le principe du mélange optique. Lorsque l’on regarde La Moisson de près, on voit des centaines de petits points texturés d’une multitude de couleurs pastel : rose, jaune, mauve, orange, vert et bleu. On dirait des bonbons haricots, des Jelly Beans en bon français, dispersés pêle-mêle sur le canevas. Mais, dès qu’on prend du recul, toute la magie s’opère : on se retrouve devant un paysage rural où une jeune femme à la taille fine occupe le centre gauche de la toile. Elle est au pré puisque s’élèvent autour d’elle quelques frêles arbres dont le feuillage jaunâtre, au premier plan, voile un ciel nuageux. Le vent caresse les feuilles de ces arbres. Les cheveux blonds de la jeune femme sont attachés. Elle porte une chemise blanche déboutonnée qui laisse voir sa gorge et dont les manches sont retroussées et une longue jupe ample bleu-gris. Dans ses bras dénudés, elle porte une gerbe de blé, la moisson, qui sent bon la chaleur de l’été. Sa tête et son corps sont tournés vers un amas de céréales qui se trouve à sa droite et auquel elle ajoutera sa gerbe dorée. Au second plan, derrière elle, on voit un deuxième amoncellement de céréales qui sèche sous les rayons du soleil. Lorsque la jeune femme se déplace, ses pas font craquer les brindilles sur lesquelles elle marche. Il est aussi fort à parier qu’il doit y avoir des insectes, des mouches, des sauterelles, qui fuient ses pas. Derrière elle, un champ vallonneux où le soleil perçant les nuages frappe dru. On aperçoit, au loin, vers le centre droit de la toile, deux autres parcelles de culture différentes desquelles s’élève le chant de la cigale. Ces parcelles sont de cultures différentes puisque Clapp ne les a pas toutes peintes des mêmes couleurs. L’une tire sur le jaune doré, comme la gerbe dans les bras de la jeune femme, tandis que l’autre est plutôt verdoyante. Au dernier plan, vers la droite, on aperçoit coincé aux pieds de deux montagnes un village où se dresse le clocher d’une église. Peut-être le bedeau y sonne-t-il l’angélus. La jeune femme fera moudre son blé chez le meunier du village. Elle transformera sa farine en pain ou en gâteau. Finalement, on l’imagine, en fin d’après-midi, rentrer au bercail, sourire aux lèvres.
La Moisson, lumineuse et chaude, est un bel exemple de la peinture néo-impressionniste à laquelle Clapp s’est consacré en adaptant la force de la palette des couleurs des courants européens à une iconographie considérée comme typique de la vie rurale québécoise.
Quelles sont vos impressions ? Avez-vous des questions ? Qu’aimeriez-vous que je détaille de plus ?